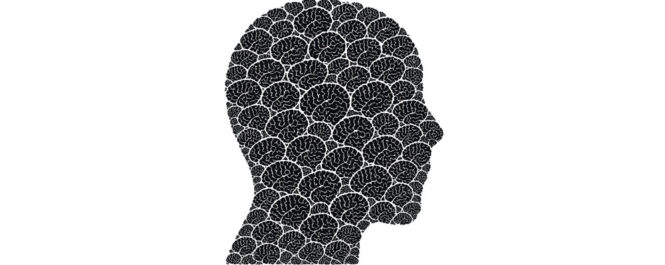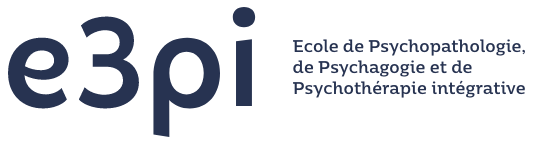

La psychagogie, une longue histoire qui n’est pas près de se terminer
Psychiatre fondateur de la psychagogie scotocentrée, dont le dernier ouvrage “Analyse psychagogique des rêves” réactualise la psychagogie comme mode de traitement des souffrances psychiques, Patrick Lambert retrace pour nous l’histoire de cette approche thérapeutique qui contribue à une prise en charge intégrative du patient.
La psychagogie, un concept né au XVIe siècle
Pour bien comprendre le début de l’histoire de la psychagogie, penchons-nous sur ce XVIe siècle qui a vu naître successivement les concepts de psychologie et de psychagogue.
« La psychologie » est un mot d’origine germanique, qui désignait en 1560 la science de ce qui relève de l’immortalité dans la matière mortelle. Cette part immortelle, pour l’école animaliste, était l’âme, partagée par le monde animé, les animaux. Pour l’école spiritualiste, à cette âme venait s’ajouter chez l’homme l’esprit, perfection innée. Le spiritualisme prévalait dans le monde chrétien, car les monothéismes font des animaux des êtres créés pour l’homme, et utilisable sans réserve pour lui. De nos jours, ce débat se poursuit entre spéciste et antispéciste.
C’est dans ce contexte qu’est né en 1587 « le psychagogue ». Puisque la psychologie permettait d’aller à la rencontre des âmes, l’influence éventuelle qu’il serait possible d’exercer sur celles-ci fut envisagée, et confiée au scientifique maîtrisant cette science nouvelle qu’est la psychologie, à savoir le psychagogue. Il est donc important de noter que pendant les deux siècles qui suivent, les praticiens de la psychologie étaient des psychagogues, le terme « psychologue » ne faisant son apparition qu’en 1760.
Que deviennent les psychagogues, remplacés par les psychologues au XVIIIe siècle ? S’étant vu confier dès 1805 la faculté de redonner vie aux âmes, en contre-point des psychopompes, tel le dieu égyptien Thot, ainsi désignés en 1823 pour accompagner les âmes dans l’au-delà, ils furent entre science et spectacle, les vedettes de fantasmagories où les fantômes avaient la parole. Il faut rappeler que Paris, au XIXe siècle, drainait un public friand de cette science spectaculaire, du baquet magnétique de Franz MESMER, à l’hypnotisme de Jean CHARCOT.
Évolution de la psychagogie depuis le XXe siècle
C’est au XXe siècle que la psychagogie prend sa forme actuelle. Ce siècle avait débuté avec l’apparition en 1907 du mot « psychanalyse », construit sur le mot germanique de « Psychoanalyse » créé 11 ans plus tôt. En 1927, « la psychagogie », après 340 ans d’histoire, devient l’application des principes de la psychologie à la direction morale d’une personne. Il s’inscrit à nouveau en contre-point, non plus du psychopompe, mais ici d’une méthode d’investigation des processus psychiques restés inconscients, la psychanalyse. L’investigation de la psyché, alors qu’elle se fait en regardant le passé du sujet pour la psychanalyse, se fait pour la psychagogie en considérant le futur de la personne, sa direction morale.
Le XXIe siècle voit la psychagogie poursuivre sa démarche intégrative :
- Avec les psychologues qui se souviendront que leurs aînés furent des psychagogues pendant près de deux siècles ;
- Avec les psychopompes, Hermès, Apollon, Charon, jusqu’au Dieu de l’Apocalypse, tous considérés « conducteurs des âmes », qui furent pendant les 250 années qui ont précédées l’invention du terme des psychagogues ;
- Avec enfin les psychanalystes, qui comme les psychagogues décrivent une psyché sous influence de l’inconscient, dont l’investigation peut révéler son rôle négatif pour les uns, comme cause de psychopathologies, et positive pour les autres, en tant que ressources curatives.
Vous souhaitez vous former à l’approche psychagogique ? Patrick Lambert vous donne rendez-vous du 7 au 10 mars et du 11 au 14 avril 2025 pour deux sessions de formation à l’analyse psychagogique des rêves.
Patrick Lambert
Praticien Hospitalier Honoraire, psychiatre fondateur de la psychagogie scotocentrée, président d’E3PI, auteur de Analyse psychagogique des rêves : l’inconscient revisité et scotocentré.
Directeur et formateur E3PI en Psychopathologie, Analyse psychagogique des rêves, et Psychologie complexe selon Jung.