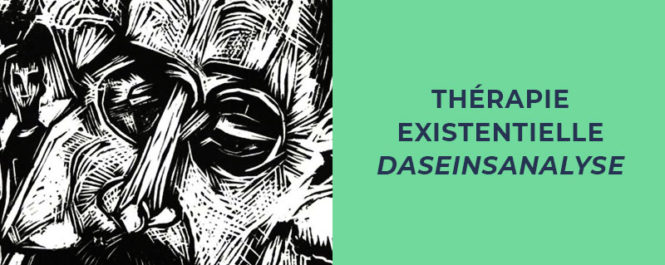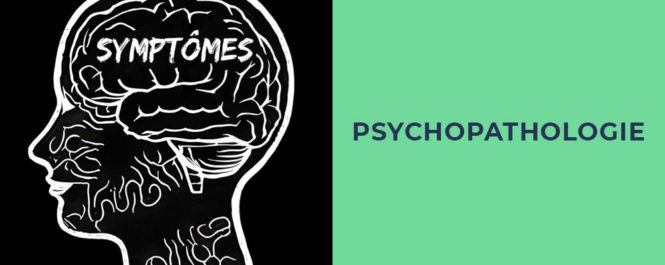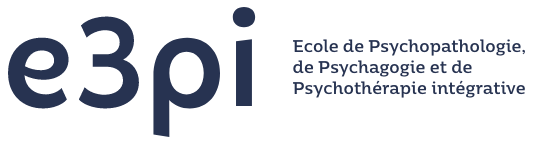

Le devenir des victimes de la délinquance sexuelle, par Patrick Lambert
Quelles sont les conséquences psychologiques à court et long terme pour les victimes de la délinquance sexuelle ?
Les études d’impact sanitaire et épidémiologique des crimes sexuels sont rendues difficiles par la sous-déclaration de ceux-ci. Les mesures de prévention sont en conséquence difficiles à établir. Il n’en reste pas moins que quelques articles de la presse scientifique donnent des pistes de compréhension et d’action.
Quelle est l’étendue du problème ?
Les victimes de pénétrations forcées des orifices naturels, comme la bouche, l’anus ou le vagin, représentent classiquement en Occident une femme sur six, elles-mêmes représentant 5/6e des victimes. Près de la moitié des garçons avaient moins de 12 ans lors des premières agressions, une sur cinq chez les filles. La dénonciation des faits n’est effective qu’une fois sur vingt quand les abus sont d’origine extra-familiale, taux qui tombe à 2% en cas d’inceste. Quand la victime est adolescente, un tiers des auteurs ont moins de 18 ans.
Dans neuf cas sur dix, le ou les auteurs sont connus ; plus d’un tiers des victimes se taisent. Quand il y a dénonciation du crime sexuel, elle est le plus souvent différée, avec une latence de plus de 5 ans dans près de la moitié des cas ; et en cas d’inceste, la révélation ne survient avant 18 ans que dans un tiers des cas.
D’où vient cette réticence à dénoncer les délinquants sexuels ?
Les dommages provoqués résident moins dans l’acte sexuel que dans le traitement de l’agression sexuelle. Sa révélation entraine l’intervention d’officiers de police, d’avocats, de juges, d’experts médicaux et d’assistants sociaux qui tous participent à la victimisation du sujet, qui subit ainsi un sur-accident. Lorsque les décisions de justice sont rendues publiques, et lors de la publication dans les media de photographies de la personne inculpée, survient pour la victime un nouveau stress traumatique.
Ces crimes ont une spécificité. La plupart du temps il existe un lien affectif ou financier entre la victime et son agresseur. L’enfant mineur, ou la personne qui défend ses intérêts, a souvent en conséquence des réticences à dénoncer l’auteur.
Quelles sont les conséquences psychologiques ?
Les conséquences psychologiques sont importantes. Tout d’abord, quelles sont les conséquences à court terme d’un acte pédocriminel ? Une étude parue dans Nature Human Behaviour en 2021 comparait, dans une population féminine des 12 à 16 ans, le devenir à deux ans d’une victime d’agression sexuelle. Le risque d’être cyber-harcelée est multiplié par trois par rapport à une population témoin. Cela est dû à une activité sur la toile électronique plus intense chez ces sujets. Même si la fréquentation des sites pornographiques de leur part n’est pas plus importante, le comportement de la victime l’expose à plus de sollicitation du registre sexuel, et l’engage dans sa réalité à une activité sexuelle plus précoce et plus fréquente.
À plus long terme, les conséquences d’une agression sexuelle sont :
- Les addictions, et en particulier aux boissons alcooliques ;
- Les troubles anxieux, qui décompensent souvent en trouble dépressif ;
- L’isolement social, et son corollaire la tentative de suicide.
La personne victime d’une agression sexuelle, du simple voyeurisme par un proche, au viol brutal par un inconnu, a souvent un sentiment d’avoir été trahie, par une personne, un groupe, ou la société dans laquelle elle évolue. Elle a besoin de retrouver ce sentiment de sécurité perdu, de restaurer une réhabilitation, suite à la perte des capacités sociales qui constituaient son autonomie. Dans ce cheminement difficile, la maladie psychiatrique, et l’identité victimaire, avec ses rechutes, menacent de s’installer.
Patrick Lambert
Psychiatre, praticien hospitalier au CHU de Nantes, diplômé en médecine légale, responsable du Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel du secteur 1 de l’agglomération nantaise, psychothérapeute fondateur de la psychagogie scotocentrée, auteur de “L’analyse psychagogique des rêves”, éditions Fabert.
Directeur et formateur E3PI en Psychopathologie et Analyse psychagogique des rêves.